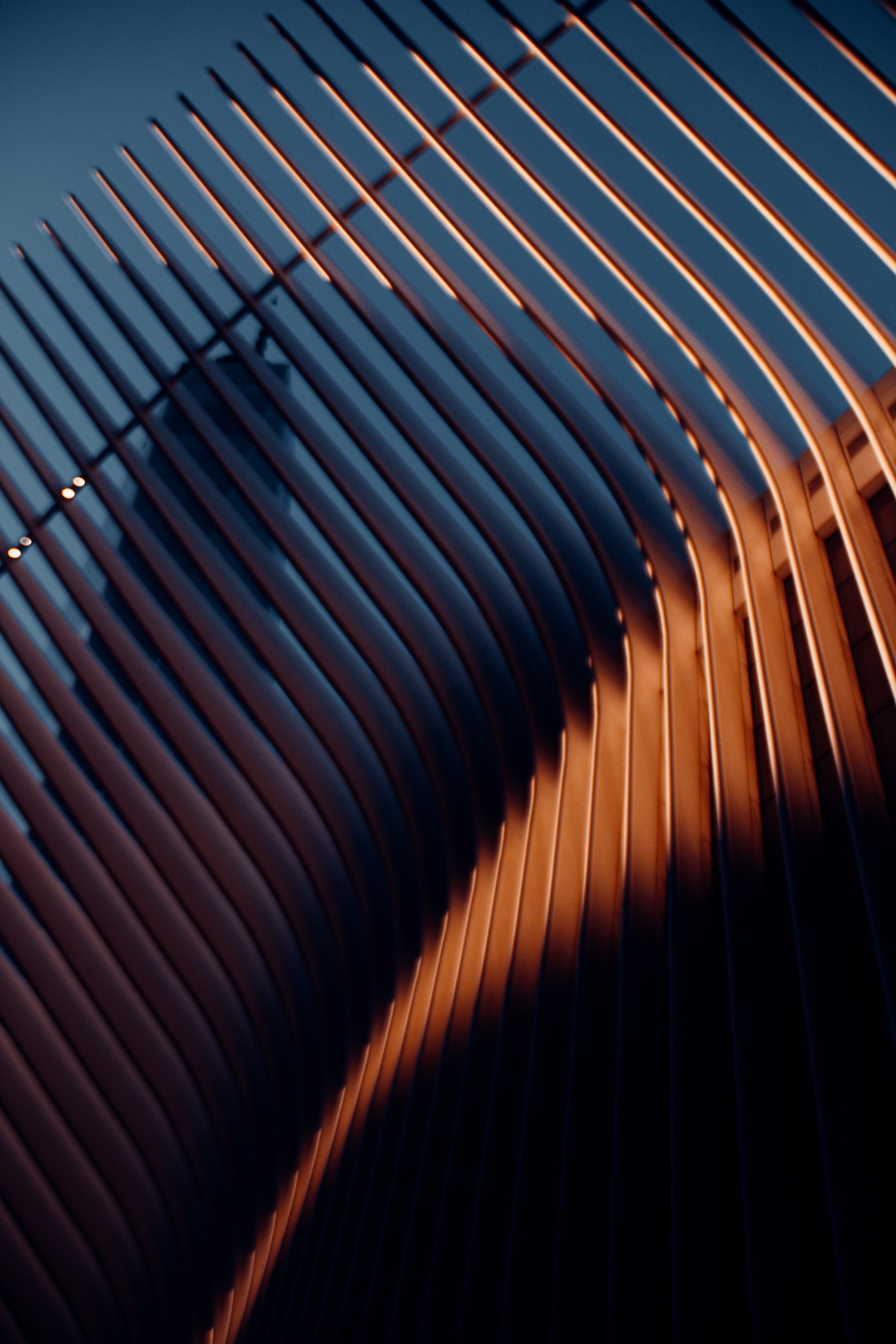Pour satisfaire le principe de sécurité juridique, premier objectif affiché de la réforme, l’Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 a codifié l’essentiel de la jurisprudence et tenté de réduire les cas d’intervention judiciaire. Pour autant, le juge n’a rien perdu de son autorité et dispose d’un large pouvoir d’interprétation et même de révision du contrat.
Attendue depuis le bicentenaire du Code civil en 2004, la réforme du droit des obligations entrera en vigueur le 1er octobre prochain. Le premier objectif de cette réforme était de garantir la sécurité juridique, mise à mal par deux cents ans de jurisprudence « par essence fluctuante (…) [qui] peut être ressentie par les acteurs économiques comme difficilement accessible et complexe dans son appréhension. »1
Or, cette jurisprudence a, pour l’essentiel, été confirmée et les pouvoirs du juge, présentés comme un obstacle à la lisibilité du droit, ont été élargis dans le but de « préserver les intérêts de la partie la plus faible » (I).
Plus puissant, le juge devrait néanmoins être moins présent puisque les parties se voient attribuer de nouvelles prérogatives destinées à réduire les cas d’intervention judiciaire (II).
I/La réforme permet au juge de remettre en cause la liberté contractuelle
Le pouvoir normatif du juge dans le contrôle de la validité des contrats a été renforcé au détriment du principe de prévisibilité de la règle de droit. Ainsi, pour être valables, les contrats devront avoir été négociés de bonne foi ; au juge donc de définir ce que sera ici la « bonne foi » et a contrario de distinguer la mauvaise foi de ce qui relève simplement de la recherche d’un avantage concurrentiel, inhérente à toute entreprise commerciale…Le nouvel article 1171 invite également le magistrat à définir, dans les contrats d’adhésion, ce qui constitue un «déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties » qui ne porte « ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation ». Enfin, indépendamment de toute menace 2, le juge pourra sanctionner l’abus de « l’état de dépendance » si son auteur « en tire un avantage manifestement excessif », sans qu’aucune de ces notions ne soit définie. À cet égard, si la réforme échoue à apporter la « vision claire et précise de l’état du droit positif »3 attendue, il n’y a là aucune originalité : le rôle traditionnel du juge est bien de combler les lacunes de la loi. En revanche, à compter du 1er octobre, le juge pourra s’immiscer dans le contrat et le modifier. Ainsi, en cas d’exécution imparfaite, le juge pourra procéder à une réduction proportionnelle du prix alors que l’abus dans la fixation du prix ne pouvait donner lieu qu’à indemnisation. Le juge a donc une prérogative économique susceptible de faire l’objet d’une expertise et de ralentir la procédure4. Plus encore, en cas de « circonstances exceptionnelles » rendant l’exécution « excessivement onéreuse », le juge peut « adapter » le contrat et même le « réviser ». « Révolution copernicienne »5 pour certains, l’article 1195 nouveau porte un coup dans l’aile au principe de la force obligatoire des contrats et met un terme à la jurisprudence « Canal de Craponne »6. Désormais, il faudrait craindre que le juge ne se mêle de redéfinir le produit ou la prestation à livrer, de changer le prix, de modifier les délais ou d’aggraver les garanties7… L’avocat rédacteur d’actes, auquel il ne pourrait pourtant pas être reproché de n’avoir pas prévu l’imprévisible, aura du souci à se faire si le contrat qu’il a lui-même rédigé pouvait se trouver à ce point attaqué. La portée du pouvoir de révision du juge doit cependant être nuancée : si l’esprit du texte est respecté, son utilisation devrait être exceptionnelle : « L’imprévision a (…) vocation à jouer un rôle préventif, le risque d’anéantissement ou de révision du contrat par le juge devant inciter les parties à négocier. »8. En inspirant la crainte d’un juge tout puissant, le nouveau droit des obligations incite les parties à s’en passer.
II/La réforme encourage les parties à éviter le recours au juge
En effet, la réforme permet au créancier insatisfait de prendre des mesures destinées à surmonter les difficultés d’exécution, sans intervention judiciaire. En matière d’exception d’inexécution, l’Ordonnance du 10 février 2016 va plus loin que la jurisprudence en admettant une exceptio temporis. Une partie peut, sans y être autorisée, suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est «manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas » et que les conséquences en sont « suffisamment graves » pour elle. De même, l’article 1221 nouveau prend le contre-pied de l’actuel article 1142 en admettant pour les créanciers la possibilité de poursuivre l’exécution forcée en nature sauf en cas de « disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier ». L’article 1222 leur offre aussi la faculté de faire exécuter l’obligation par un tiers, à la seule condition que le coût et le délai soient « raisonnables »…
Enfin, en cas d’inexécution, le créancier peut mettre fin au contrat après une simple notification. Le juge n’aura plus qu’à contrôler a posteriori l’exercice par les parties de leurs nouvelles prérogatives. Personnage devenu secondaire, le rôle du juge ne doit cependant pas être minimisé : l’étendue de son pouvoir d’appréciation est à la mesure des standards flous et des qualifications relatives9 visées par les textes. Il est cependant inévitable qu’« une foule de choses [soient] nécessairement abandonnées à l’empire de l’usage, à la discussion des hommes instruits, à l’arbitrage des juges. »10
Article écrit par Antoine CHATAIN et paru dans le Magazine Décideurs « Paroles d’Experts », septembre 2016